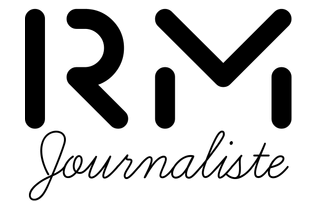La balance migratoire du Venezuela n’a jamais été négative au cours de son histoire. A la différence d’autres pays de la région et d’ailleurs, le Venezuela n’avait jamais connu le départ massif de ses concitoyens. Bien au contraire, le pays caribéen a toujours été une terre d’accueil pour ceux qui rêvaient d’un second départ que ne pouvaient leur offrir leur patrie d’origine. En premier lieu, les colombiens fuyant la guerre et les politiques d’austérité dans leur pays. Ils sont plus de quatre millions à avoir passé la frontière et s’être établis au Venezuela. Mais aussi l’Equateur dont la communauté établie au Venezuela reste la plus grande en Amérique Latine. De nombreux citoyens du cône sud du continent ont aussi trouvé refuge dans le pays de Bolivar au moment où la botte militaire écrasait dans le sang toute velléité démocratique au Chili, en Uruguay, ou en Argentine.
Cette immigration massive ne s’arrête pas aux pays de la région. Le Venezuela compte une des plus grandes communautés syro-libanaise de la région, et par vagues successives des milliers d’espagnols, d’italiens et de portugais sont venus s’y enraciner.
L’immigration européenne au Venezuela a vu se constituer des branches de métiers en fonction de la nationalité : les italiens sont majoritaires dans le secteur de la construction, les portugais ont réussis à s’imposer dans les épiceries et les boulangeries, et de très nombreux espagnols se sont implantés dans la restauration. Après l’Argentine et la France, le Venezuela est le troisième pays qui compte le plus de ressortissants ibériques au monde. Et pourtant, malgré le flux continu d’immigrés espagnols jusque dans les années 70, jamais les gouvernements vénézuéliens successifs n’ont exigé d’intervention humanitaire contre le régime franquiste.
Sage décision, car Caracas est désormais la ville d’Amérique Latine où l’on trouve le plus de tascas, ces fameux restaurants espagnols, d’une qualité jamais retrouvée en France.
C’est dans l’un d’eux que nous décidons d’aller manger avec Solka, un samedi midi. Situé dans le centre de Caracas, caché derrière les barres d’immeubles hideuses de Parque Central, El Limón -le citron-, est une des meilleures tascas de la ville. Première surprise en poussant la porte : le restaurant est plein à craquer. Pas une table de disponible sur les 70 couverts proposés par l’établissement.
C’est la norme le week-end dans tous les restaurants de la ville. Les clients sont nombreux, soit parce qu’ils ont pu revendre des devises internationales, soit parce qu’ils commercent en bolivar au taux du marché noir, ou soit parce qu’ils se font une folie temporaire. Les classes moyennes et supérieures, celles qui critiquent le plus le gouvernement se portent très bien. Ces contradictions liés au mode de production vénézuélien ont toujours existé, mais avec la spéculation contre la monnaie nationale, le fossé s’est amplifié entre le pays Dolar Today, minoritaire mais nombreux, et le pays Clap, composé de ceux qui ne peuvent suivre l’augmentation continuelle des prix (1).
Toujours est-il qu’il faudra qu’on attende notre tour au bar. Qu’a cela ne tienne. On avait tout les deux envie d’une bière bien fraiche. Aussitôt dit, aussitôt fait, le barman nous amènent deux Polar glacées, et nous trinquons en regardant une valse de serveurs en costume portant paellas et arroz asopado, lechón a la brasa et pulpo a la gallega.
Solka est une diplomate vénézuélienne de 35 ans. Elle est originaire de San Cristobal, ville frontalière avec la Colombie. Sa famille, binationale, est répartie entre les deux pays. Son élégance se combine à merveille avec sa connaissance pointilleuse de la géopolitique latino-américaine et de la situation actuelle de son pays. C’est aussi une amie de longue date.
Le toast laisse place à la conversation. J’essaie péniblement de rester concentré sur ses paroles, et de ne pas me laisser complètement absorbé par le magnétisme céleste de ses yeux gris-bleus. Mais la tournure grave que prend la discussion me sort de ma torpeur poétique.
« Mon père est malade, me dit-elle. Il a des problèmes de reins et doit faire une dialyse. Ces dernières semaines, j’ai passé le plus clair de mon temps à lui chercher une clinique qui puisse lui faire son traitement, et je me démène tous les jours pour acheter les médicaments dont il a besoin. C’est un vrai casse-tête. Une grande partie de ma vie tourne autour de la santé de mon père. Entre lui et mon fils, je ne sais même plus la dernière fois que je suis sortie comme en ce moment».
Ne sachant pas trop quoi renchérir, je fais signe au serveur de nous remettre deux bières.
Le décret exécutif 13692, signé en mars 2015 par l’ancien président des Etats-Unis Barack Obama, a permis d’organiser un blocus criminel contre le pays bolivarien. Sous le prétexte fallacieux que le Venezuela représentait une « menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité des Etats-Unis », ce décret est la pierre angulaire des mesures prises pour étouffer économiquement le pays bolivarien. En congelant des comptes ou des actifs appartenant à l’Etat vénézuélien, le but recherché est de l’assécher financièrement et d’empêcher la normalité des transactions commerciales.
Dans le domaine de la santé, l’effet est dévastateur. Le Venezuela importe en effet la majorité des médicaments dont il a besoin. Avant le décret Obama, 64% de ces importations provenaient des Etats-Unis, ou de pays européens et latino-américains alignées sur les politiques de Washington.
En juillet 2017, le gouvernement vénézuélien décida d’importer des doses d’insuline destinées à être distribuées dans les hôpitaux publics du pays. La banque étasunienne Citybank refusera le transfert d’argent, privant ainsi 450.000 diabétiques d’avoir accès à leur traitement.
Quelques mois plus tard, en octobre de la même année, le Venezuela a voulu acheter des vaccins à l’Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS) (2). A cause de l’extraterritorialité des lois états-uniennes, la banque suisse UPS rejettera le paiement, provoquant un retard de 4 mois dans la livraison des vaccins et déstructurant complètement le système public de vaccination gratuite du ministère de la santé vénézuélien.
En novembre 2017, un nouveau cap est franchi. Les transnationales pharmaceutiques Baster, Abbot, et Pfizer refusent d’emmètre des certificats d’exportation à destination du Venezuela, rendant impossible l’achat de médicaments produits par ces entreprises, notamment dans le domaine oncologique.
Enfin, en ce début du mois de mai 2018, 9 millions de dollars de l’Etat vénézuélien sont congelés. Ils étaient destinés au traitement de la dialyse. 20.000 patients en seront privés, dont le papa de Solka.
Le serveur nous fait signe qu’une table s’est enfin libérée.
« Le blocus me pourrit la vie, me dit Solka, ses yeux rivés sur le menu. Les médicaments sont difficiles à trouver, ce n’est pas comme les aliments, où avec de l’argent tu peux tout acheter.
– Et concrètement comment tu fais ?
Long soupir.
« Je résous, me répond-elle. Je fais le tour des pharmacies pour trouver ce dont j’ai besoin. Il y a aussi les réseaux d’entraides : plusieurs amis ou collègues m’ont aidé à trouver certains médicaments dont j’avais besoin, quand ils ne me donnaient pas ceux qu’ils possédaient et qu’ils n’utilisaient pas. Dans les cas extrêmes, ma famille colombienne m’en a envoyé de Bogota par Fedex.
– Par Fedex ? répondis-je interloqué. Ça fait cher la boite de paracétamol.
– Mais non, tonto (3), dans ce cas là, c’est pour des médicaments plus spécifiques et je les achète en plus grande quantité. Ça fait quand même mal de les faire venir de Colombie, lorsque l’on sait qu’il existe des réseaux de contrebande qui font passer les médicaments que l’on importe, de l’autre coté de la frontière. C’est comme si je les achetai deux fois…
Le serveur s’approche de nous : « Je prend votre commande? »
Solka s’incline pour le poulpe à la galicienne. Très bon choix. Il est excellent.
«Et pour vous Monsieur ?
– Moi, je vais prendre la brochette de mérou et calamars à la bisque de crevette.
– Très bien, et comme accompagnement ?
– Une boite d’antibiotiques. Amoxicilline, ça m’ira très bien.
Le serveur, amusé par la réponse, me répond :
« Oh ça, je crois que ça ne va pas être possible, mon ami.
– Bon, ça sera des frites alors.
Situation surréaliste où l’achat d’une boite d’antibiotique relève d’un parcours du combattant.
Quelques jours auparavant, Nicolas Maduro s’est réuni avec Carissa Etienne, directrice de l’OPS, dans le but d’importer des médicaments et de trouver une solution pour contourner le blocus sanitaire. Le président proposera que les Clap assume directement la distribution d’une partie de ces médicaments pour contourner les réseaux de contrebandiers.
« Le problème c’est l’attention et la distribution. Il faudrait renforcer la distribution à travers de nouveaux mécanismes comme le carnet de la Patrie ou les Clap, me lache Solka.
– Ça peut fonctionner ?
– Ça ne marche pas trop mal pour les aliments non périssables. On verra bien »
Le poulpe et le mérou n’étant plus qu’un lointain souvenir, je lui demande :
– Maintenant ? rit-elle, on va aller chercher mon père et on l’emmène à la clinique. »
Prochain épisode : Le chauffeur sans ses bus
et pour lire ou relire les autres épisodes, cliquez ici
Notes :
(1)Voir Romain Migus, “Entre mesures d’urgence et construction de l’Etat (Chroniques d’en bas nº4)”, Le Grand Soir, https://www.legrandsoir.info/venezuela-entre-mesures-d-urgence-et-construction-de-l-etat-chroniques-d-en-bas-no-4.html